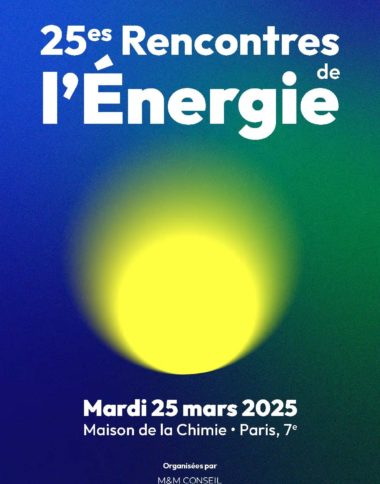Articles
Temps de lecture : 3 min
14/02/2025
Changement climatique et compétitivité. Comment les exploitations françaises s’adaptent-elles ?

C’est pour tenter de répondre à cette question complexe de la conciliation entre enjeux économiques et climatiques pour les exploitations agricoles que l’Académie d’agriculture de France a organisé cette journée de conférence “Etat de l’agriculture 2025”, qui s’est déroulée mercredi 5 février 2025 dans les locaux de la Fédération Nationale du Crédit Agricole.
Après les interventions des chercheurs de l’INRAE Thierry CAQUET et Vincent CHATELLIER, suivies des retours de terrains de Diane MASURE et de Valérie BLANDIN, cheffes d’entreprise agricoles, ainsi que des témoignages de Camille GUERIN, responsable agriculture régénérative Europe continentale McCain et Laurent HEDOU, directeur de la production laitière des Maîtres Laitiers du Cotentin, deux tables rondes ont été animées par Agridées. La première a mis en lumière les différents moyens d’adaptation des exploitations agricoles au stress hydrique et la seconde a plus précisément exploré les leviers de la génétique pour trois filières (élevage de ruminants, semences et viticulture).
“Comment s’adaptent les exploitations agricoles au stress hydrique ?”

Aymeric MOLIN, agriculteur et CEO d’Elicit Plant, a expliqué son « obsession » de l’eau dans les sols de son exploitation agricole, marqués par la sécheresse et un faible potentiel agronomique caractéristique de la zone dite intermédiaire. Il a évoqué tous les leviers utilisés pour retenir l’eau dans les sols : leviers agronomiques (agriculture de conservation des sols, augmentation du taux de matière organique des sols, diversification des assolements, changements d’itinéraires techniques), leviers génétiques, amélioration de l’efficacité de l’irrigation, et enfin utilisation de phytostérols (proposés par Elicit Plant) pour diminuer la consommation d’eau. Il a été question de l’importance de la diversité des adaptations, des solutions, de la complémentarité et de l’importance du dialogue… Aymeric Molin a également évoqué l’importance de la structuration de filières créatrices de valeur ajoutée et de la nécessité de l’implication des acteurs de l’amont afin que les risques pris par les agriculteurs soient mieux partagés.
Jerome LEROY, CEO de Weenat et président de La Ferme Digitale a quant à lui abordé l’importance des données et de la mesure de l’humidité dans les sols afin de comprendre le comportement des sols, leur profil et les besoins précis en eau. L’application Weenat permet d’accéder à des données en temps réels et le pilotage fin et économe de la ressource en eau, de l’énergie, mais aussi du stress des agricultrices et des agriculteurs irrigants. Couplées à des données météo et pédologiques, ces informations sont utilisables par des collectivités ou des coopératives comme des outils de comptabilité environnementale et de prospective. Jérôme Leroy a cependant déploré que cette étape fondamentale de la mesure et de la compréhension par les données soient encore trop peu connues et utilisées.
Guillaume BENOIT, académicien, qui préside un groupe de travail sur l’eau au Partenariat Français pour l’Eau – French Water Partnership – et cumule une grande expérience sur les sujets du changement climatique, de l’adaptation et de l’eau, a éclairé les échanges sur le rôle fondamental des sols et de l’irrigation dans l’adaptation au changement climatique. Il a expliqué la notion d’irrigation de résilience, qui a fait consensus entre Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et Ministère de l’Environnement et de la Transition écologique. Il a rappelé que le GIEC a classé la perte de revenus des agriculteurs comme un des huit grands risques induit par le changement climatique.
Les échanges ont mis en avant l’importance de ne pas dissocier les politiques environnementales de celles œuvrant pour la compétitivité des exploitations, en particulier à l’échelon territorial. A également été relevée l’importance de faire remonter les expériences réussies à l’échelle des « territoires de vie » jusqu’à l’Etat français pour une “contamination positive”. Guillaume Benoît a expliqué la notion de « gouvernance en W », où le terrain et l’état se rencontrent en permanence, qui va à l’encontre du fonctionnement actuel en silos. Il ressort une mise en avant des compromis, du dialogue, de consensus avec des agriculteurs et des agricultrices qui doivent rester au cœur de la santé des sols et dont les changements de pratiques doivent être valorisés à la hauteur des services rendus pour la société.
“Quelles sont les perspectives offertes par la génétique ?”

Laurent JOURNAUX, directeur de l’interprofession France Génétique Élevage, a souligné l’importance de l’investissement en génétique dans les filières des ruminants (lait/viande) jusque-là tournées avec succès vers les performances des animaux (longévité, fertilité, viabilité, efficacité alimentaire…) et la qualité des produits. La sélection génomique française, réputée sur le plan international, permet désormais de s’intéresser également à l’adaptation des systèmes de production confrontés au dérèglement climatique (humidité, température) et de contribuer à la lutte contre les maladies émergentes y compris lorsqu’il n’y a pas de réponse vaccinale ou thérapeutique. La génétique, un levier à objectifs multiples.
Franck PRUNUS, directeur des services à la filière au sein de l’interprofession des semences et plants -SEMAE- tout en rappelant le rôle de locomotive des filières semences pour l’économie agricole, notamment à l’international, et le renouvellement permanent du catalogue variétal au bénéfice des agriculteurs, s’est interrogé sur la complexité d’apporter des réponses aux dérèglements climatiques. Ainsi l’hétérogénéité et la variabilité des impacts, le cumul des stress biotiques (ravageurs, maladies) et abiotiques (climat) et la durée de réponse de la recherche avant inscription (10 ans) entrainent une temporalité longue quelle que soit la qualité des avancées scientifiques. En complément, les outils d’évaluation des risques (tel celui développé par Axa Climate/Semae) peuvent permettre de mieux appréhender les transitions.
Laurent LOZANO, expert, viticulteur et œnologue, a montré à quel point la vigne constitue un « marqueur » visible des dérèglements climatiques du fait des aléas tels que gel, grêle, excès d’eau ou sécheresse, élévation des températures, maladies, avancée des dates de récolte…dans un système très divers selon les terroirs. Les stades phénologiques évoluent, de même que la qualité des raisins (acidité/teneur en sucre). La génétique par l’amélioration des cépages dans leur diversité ou la création de nouveaux contribue à apporter des solutions, mais sur un temps long qui peut prendre 20 ans entre le début des recherches et l’appréciation des consommateurs. Ce travail peut être complété par les apports de l’œnologie, la microbiologie des vins. Plus que d’autres filières, en viticulture seule l’association terroir/climat/génétique dans sa recherche d’équilibre permet d’imaginer les réponses aux changements climatiques ;
De ces trois interventions, il ressort que le levier génétique, aussi déterminant soit-il, ne peut être considéré comme une réponse technique unique, tant le temps long qu’il requiert voit également les impacts évoluer eux-mêmes et changer la donne en permanence. Le savoir-faire des agriculteurs, leurs compétences, sont décisives pour tracer des perspectives, avec l’appui de la science.